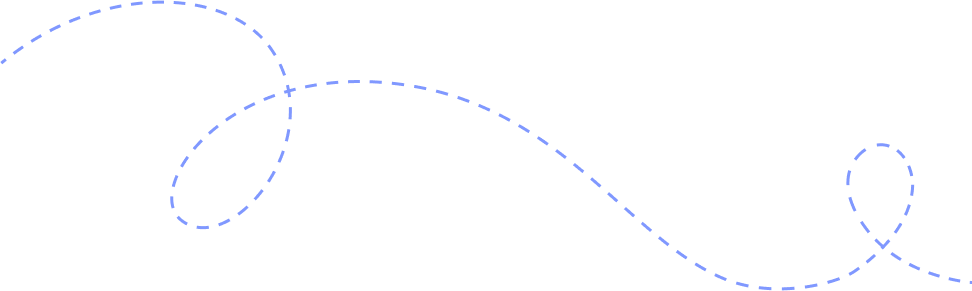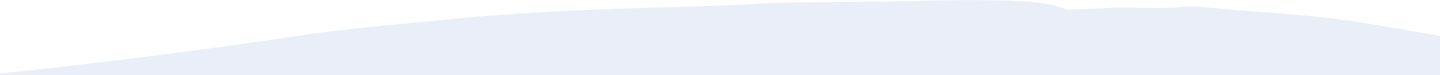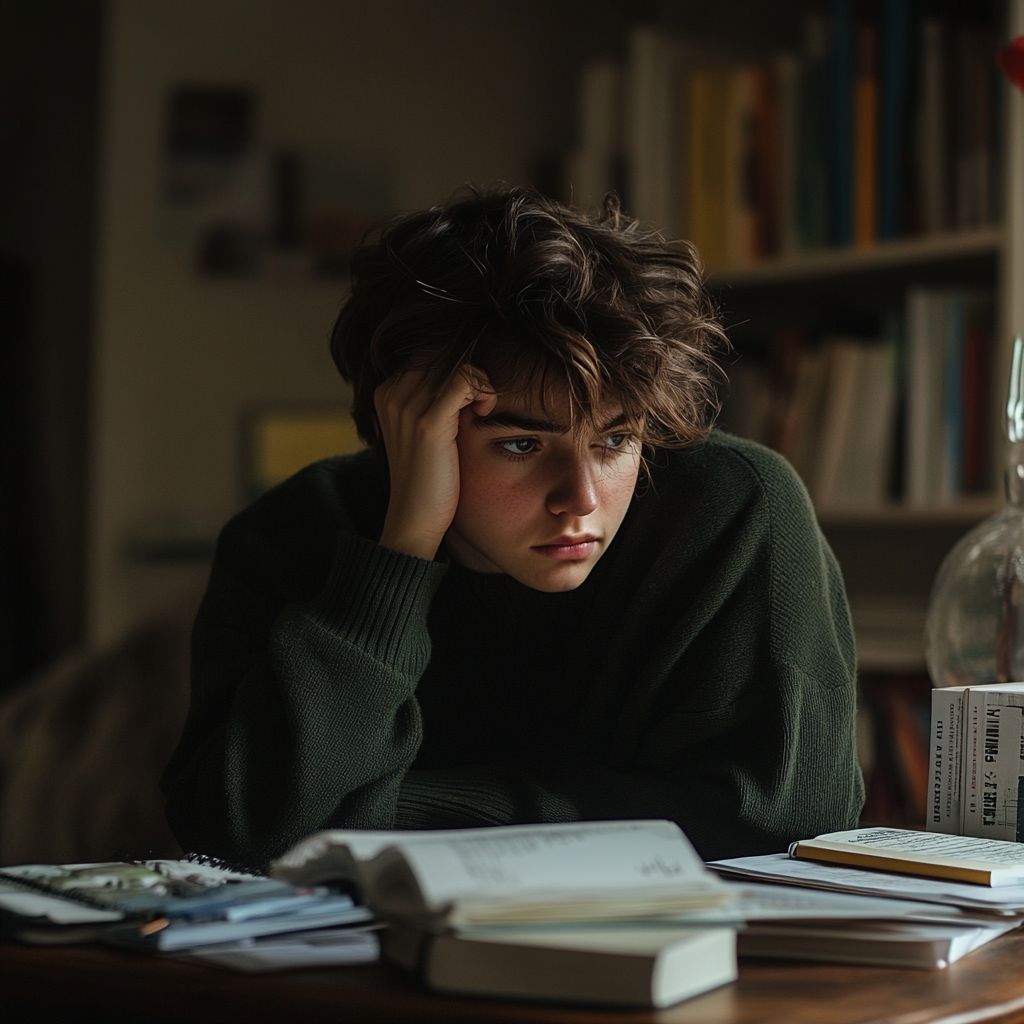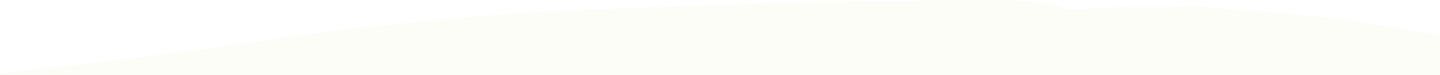La différence est une opportunité. De nombreuses études montrent que les entreprises qui favorisent la mixité hommes-femmes sont plus performantes. Je suis persuadé que c’est aussi le cas pour les organisations qui intègrent des personnes ayant des troubles psychiques, lorsque l’on parvient à collaborer efficacement ensemble.
Clément Baissat
Pour les personnes vivant avec un trouble psychique, le chemin de l’acceptation est souvent rempli de questionnements et de défis. Dans une société qui valorise l’idéal de la normalité, se reconnaître dans sa différence et accepter les particularités d’un trouble peut représenter un véritable acte de courage et d’affirmation. Accepter son trouble, c’est apprendre à vivre avec et intégrer cette facette de soi sans se laisser réduire par elle. Cet article explore les étapes vers l’acceptation de son trouble psychique, les contraintes rencontrées, ainsi que les perspectives de croissance personnelle qu’il est possible de cultiver pour vivre pleinement, sans compromis sur son bien-être.
Accepter sa différence : un acte essentiel pour le rétablissement
La première étape vers l’acceptation consiste souvent à reconnaître que le trouble psychique fait partie de soi, mais qu’il ne résume pas toute son identité. Cette distinction est cruciale pour éviter de se laisser submerger par la stigmatisation. En effet, accepter son trouble, que ce soit la dépression, la bipolarité ou les troubles anxieux, permet de trouver un équilibre entre ce que l’on vit et ce que l’on est. Les troubles psychiques ne sont pas des défauts de caractère, mais des états de santé qui influencent le quotidien sans effacer la richesse de l’individu.
D’après Santé Publique France, 1 personne sur 4 est concernée par un trouble psychique au cours de sa vie (source). Face à cette réalité, il devient impératif de normaliser le dialogue autour de ces troubles. En prenant conscience de la prévalence des troubles psychiques, on peut progressivement transformer la honte et la peur en compréhension et acceptation de soi.
Accepter sa différence implique aussi de prendre en compte ses limites et de les transformer en points de repère plutôt qu’en obstacles. Par exemple, une personne vivant avec un trouble de l’humeur peut ressentir une forte fatigue ou une difficulté à se concentrer lors de périodes plus difficiles. Plutôt que de se forcer à ignorer ces signaux, il est possible de les utiliser pour mieux anticiper les besoins et établir une routine qui respecte le rythme personnel. Ce processus de respect de soi-même est un pilier essentiel du rétablissement.

Comprendre les contraintes et relever les défis quotidiens
Vivre avec un trouble psychique, c’est composer avec des contraintes qui peuvent varier d’un jour à l’autre. Pour certains, cela signifie gérer des symptômes tels que des pensées envahissantes, des variations d’humeur, ou une anxiété accrue. Ces contraintes sont souvent perçues comme des faiblesses dans la société, mais elles peuvent devenir des forces lorsque l’on apprend à en faire des alliées.
Les troubles psychiques touchent une diversité de profils, et chaque type de trouble implique des défis spécifiques. Par exemple, une personne atteinte de trouble bipolaire peut alterner entre des périodes de grande énergie et des phases de dépression profonde, ce qui peut rendre difficile la stabilité dans la vie professionnelle et sociale. Une autre personne souffrant de troubles anxieux peut avoir du mal à faire face à des situations imprévues, ou encore à interagir avec des groupes importants, ce qui limite les options d’engagement.
Pour beaucoup, ces contraintes sont vécues comme des barrières, mais en devenant “expert” de son trouble, il est possible de mettre en place des stratégies de gestion. La psychoéducation, par exemple, aide à mieux comprendre son trouble, à identifier les déclencheurs et à adopter des comportements adaptés. Des ressources, comme celles offertes par Psycom, permettent d’explorer ces techniques et de devenir acteur de son bien-être.
Les étapes du rétablissement : un processus de croissance personnelle
Le rétablissement pour les personnes vivant avec un trouble psychique va bien au-delà de la simple gestion des symptômes. Il s’agit d’un processus d’évolution et d’adaptation qui permet de vivre une vie satisfaisante en intégrant son trouble comme une composante, et non comme une limitation. Dans ce contexte, le rétablissement est un parcours personnel qui inclut plusieurs étapes importantes : accepter la différence, se former sur son trouble, développer une routine bénéfique et maintenir une hygiène de vie qui favorise l’équilibre mental.
Les études montrent que des habitudes de vie telles que l’exercice physique, une alimentation équilibrée, et un sommeil régulier peuvent jouer un rôle essentiel dans la gestion des troubles psychiques (OMS). Ces pratiques, loin d’être anodines, contribuent à stabiliser l’humeur et à prévenir des rechutes en renforçant la résilience.
Le rétablissement est aussi un processus qui implique la construction d’une routine structurante. Un emploi du temps bien défini, des responsabilités et des projets apportent un cadre rassurant et permettent de se recentrer. Cela aide à réduire les symptômes d’anxiété et de dépression en focalisant l’attention sur des tâches concrètes et en établissant une stabilité quotidienne. Ce cadre est souvent crucial pour les personnes vulnérables, car il leur permet de construire une vie qui soit un espace de soutien et non un environnement qui intensifie leurs difficultés.
La meilleure décision que j’ai prise dans ma vie a été de réaliser que je devais prendre soin de mon hygiène de vie comme un sportif de haut niveau. J’ai accepté que j’avais besoin d’aide et de soutien, en particulier d’une équipe de soutien composée d’un psychiatre, d’un psychologue et d’un pair-aidant. C’est cela qui me permet de trouver la voie vers mon rétablissement.
Clément Baissat

Les principaux troubles psychiques : une diversité de réalités à comprendre et à accepter
Accepter pleinement son trouble, c’est d’abord bien le comprendre. Les troubles psychiques sont divers et nécessitent chacun des approches de rétablissement spécifiques. En voici une brève présentation :
- Dépression : Affecte environ 20 % de la population au moins une fois dans la vie et se manifeste par une profonde tristesse, une perte de motivation et d’énergie.
- Bipolarité : Ce trouble, qui touche environ 2-3 % de la population, se caractérise par des alternances d’épisodes maniaques et dépressifs.
- Troubles anxieux : Touchent 22 % des personnes et regroupent des troubles tels que l’anxiété généralisée, les phobies, et le trouble de stress post-traumatique.
- Troubles psychotiques : Comme la schizophrénie, qui concerne environ 1 % de la population et provoque des hallucinations ou des idées délirantes.
- Troubles de la personnalité : Par exemple, le trouble borderline, qui se traduit par une instabilité émotionnelle intense.
- Troubles de l’alimentation : Incluent l’anorexie, la boulimie, et d’autres comportements liés à des troubles émotionnels.
- Troubles addictifs : Concernent des comportements de dépendance, comme l’alcoolisme, le tabagisme, ou les addictions aux jeux.
Se documenter sur les particularités de son trouble permet de démystifier certains aspects, d’identifier les stratégies adaptées, et d’amorcer une acceptation plus sereine.
Évoluer vers une meilleure version de soi-même : embrasser sa différence
Accepter son trouble psychique n’est pas uniquement un acte de résilience. C’est aussi l’opportunité d’évoluer et de se redécouvrir. En comprenant les spécificités de son trouble, en intégrant les contraintes, et en développant des stratégies d’adaptation, chacun peut vivre pleinement tout en embrassant sa différence.
L’acceptation permet de cultiver un sentiment de paix intérieure. C’est également un chemin vers l’amélioration de soi, car apprendre à s’écouter, à respecter ses propres limites et à prendre soin de soi sont des compétences de vie qui renforcent la confiance et l’estime de soi. Des ressources comme celles d’UNAFAM offrent des conseils précieux pour naviguer ce parcours d’acceptation et de croissance personnelle.
Embrasser sa différence pour se réinventer
Le chemin vers l’acceptation d’un trouble psychique peut être long et difficile, mais il offre la possibilité de transformer une situation vécue comme un obstacle en un atout de résilience et de force intérieure. En comprenant les spécificités de son trouble, en intégrant ses contraintes et en développant des stratégies adaptées, chacun peut apprendre à vivre en harmonie avec soi-même. Accepter sa différence permet non seulement de se libérer de la stigmatisation mais aussi de découvrir des ressources insoupçonnées.
Vous vivez avec un trouble psychique ou connaissez quelqu’un dans cette situation ? Partagez votre expérience et rejoignez la conversation sur nos réseaux sociaux.